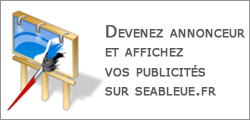Publié le 23 décembre 2012, dans Connaissance et reconnaissance des glaces, Reportages
Connaissances des glaces : la télédétection
Météorologiste marine Pascal Landure s’est lancé pour seableue dans une analyse du détail intéressante et proposée sur ce site en 4 parties dans la catégorie reportages.
Le 2ème volet : la télédétection
Etat des progrès réalisés en télédétection appliquée à la reconnaissance des icebergs et glaces de mer.
Qu’est-ce que la télédétection ?
Dans les années 1980, la télédétection fit un pas en avant avec l’apparition de la haute
résolution spatiale. mais avant de parler de l’évolution des satellites, évolution qui nous
permet d’atteindre une résolution de l’ordre de quelques mètre aujourd’hui, précisons un peu
de quoi il s’agit.
La télédétection est le processus qui consiste à capter, enregistrer l’énergie
d’un rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi puis à le traiter et l’analyser.
On parle de « télédétection passive » lorsque le capteur embarqué sur le satellite n’émet pas.
Il enregistre le rayonnement électromagnétique naturel à savoir la lumière visible mais aussi l’infra-rouge. Il travaille également dans les hyperfréquences (micro-onde).
Le radiomètre est un exemple de capteur passif.
A l’inverse, on parle de « télédétection active » lorsque le capteur embarqué émet un
rayonnement électromagnétique artificiel.
Le capteur actif est un radar qui mesure le rayonnement rétrodiffusé par les surfaces atteintes. Le diffusiomètre est un exemple de capteur actif opérant dans la gamme des micros-ondes (donc dans le domaine des hautes fréquences, des hyper-fréquences.)
L’un des avantages du diffusiomètre est que ses performances ne sont pas limitées par la couverture nuageuse à l’instar du radiomètre.
L’altimètre est également un capteur actif dont la mission principale est de mesurer le relief
des océans mais qui trouve des applications dérivées en matière de glaces et d’iceberg.
Vu du ciel :
Seasat lancé en juillet 1978 était le premier satellite spécialisé dans la télédétection (*) de l’océan, le premier aussi a embarquer le tout nouveau radar à synthèse d’ouverture SAR (Synthetic Apperture Radar) mais ne connu qu’une existence très brève.
Toujours en 1978, le satellite NIMBUS-7 allait permettre de mieux connaître la formation de la glace de mer.
Avec lui allait débuter la série des radiomètres-imageurs embarqués qui autorisaient une
bonne détermination de l’étendue des glaces de mer mais n’apportait pas d’information sur
l’épaisseur de cette glace. L’altimétrie venait alors en complément et restituait une estimation
de cette épaisseur.
Mouvements des icebergs 1999-2010. Source : NASA SCP
Site internet : http://www.scp.byu.edu/data/iceberg/database1.html
National Ice Center, 2011
Les années 90 allaient être des années riches tant par le développement des missions
scientifiques que par les progrès technologiques. C’est lors de cette décennie que les
premières missions uniquement dévolues à l’étude de l’océan virent le jour avec le lancement
de TOPEX/POSEIDON (durée de la mission : 1992-2005.)
Elles allaient mettre en avant les énormes capacités de l’altimètre. En 2001, JASON-1 était
lancé pour assurer la suite de T/P et on allait faire une découverte étonnante : alors que les
capteurs « traditionnels » (diffusiomètres, radiomètres, spectroradiomètres) ne permettaient
jusqu’alors d’apprécier que des icebergs de grande dimension (plusieurs dizaines voire
centaines de Km²), l’altimètre de JASON était capable d’isoler des icebergs de petite taille
(moins de 15m de hauteur et moins de 1 Km².) Entre décembre 2004 et novembre 2005, pas
moins de 8000 icebergs furent ainsi détectés autour de l’antarctique amenant la communauté
scientifique internationale à s’interroger devant un résultat aussi important quantitativement !
Pour compléter la série des satellites d’altimétrie, JASON-2 fut lancé en 2008.
Les années 90 allaient également confirmer les immenses capacités des radars à synthèse
d’ouverture (SAR- rappel : premier lancement d’un SAR en 1978 avec SEASAT) et
les progrès réalisés dans ce domaine permirent le lancement du programme ERS de
l’Agence Spatiale Européenne (ERS-1 : 1991-2000 et ERS-2 : 1995-2011.) Les avancées
technologiques étaient édifiantes puisque l’on atteignait alors une résolution de 25m.
Pour prolonger la série des ERS, ENVISAT fut mis en orbite en 2001 équipé de l’ASAR
(Advanced Synthetic Aperture Radar.) Son successeur, SENTINEL qui sera lancé en 2013,
perpétuera la détection des glaces par les radars ASAR.
Parallèlement, de l’autre côté de l’atlantique, l’Agence Spatiale Canadienne (ASC) lançait
le satellite RADARSAT-1 en 1995 dans un but avéré de commercialisation des produits. La
résolution de RADARSAT-2 lancé en 2007 atteint 3m ! C’est lui qui a été retenu par CLS (Collecte Localisation Satellites) pour fournir les informations sur l’état des icebergs et des glaces pour le Vendée Globe 2012.
Météorologiste marine et routeur météo Pascal Landure dispose d’un site http://www.amzervor-
Les autres articles du reportage
- Connaissances des glaces : la télédétection, 23 December 2012
- Connaissance : une carte des glaces pour le futur, 23 December 2012
- Connaissance des glaces : l’identification des icebergs, 23 December 2012
- Connaissance des glaces : les cartes des glaces, 20 December 2012